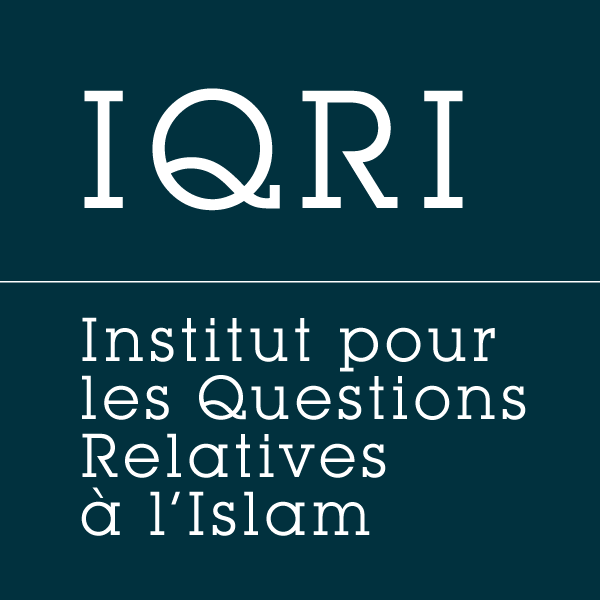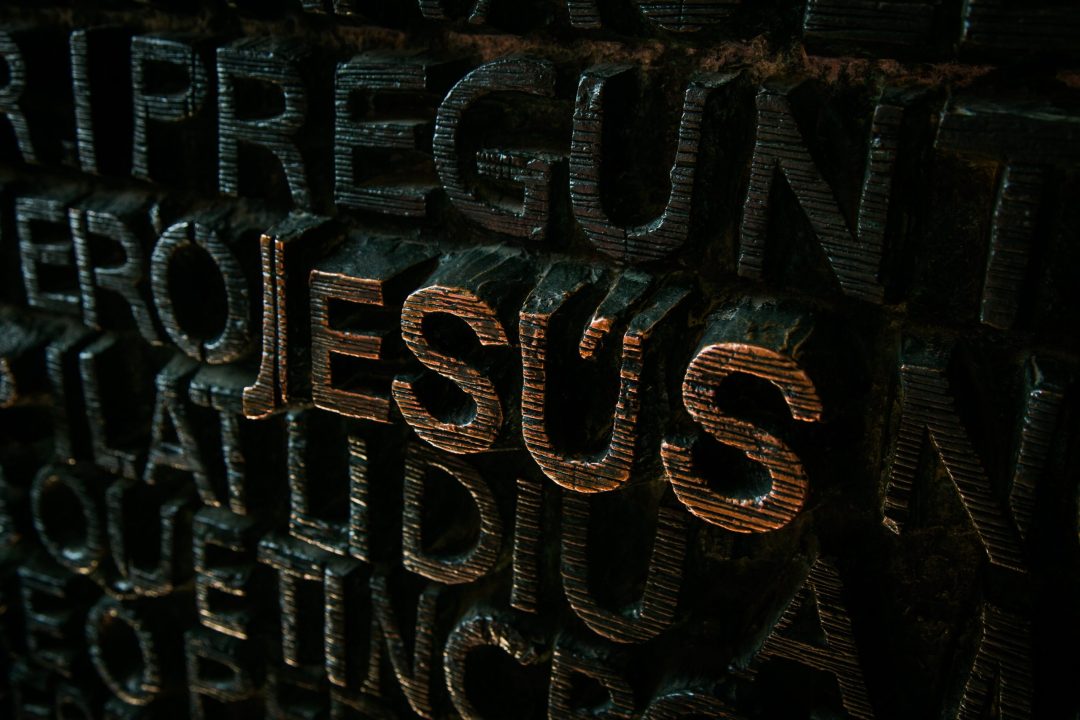En quoi la Bible diffère-t-elle du Coran. Chaque religion met en valeur son/ses « livres sacrés ». C’est le cas du christianisme pour la Bible, de l’islam pour le Coran. La question ici est de savoir ce qui différencie la Bible de tous les autres livres religieux.
Commençons par voir comment ces textes se présentent eux-mêmes, avant de nous arrêter sur quelques-unes de leurs différences.
PANORAMA DES TEXTES SACRES
La Bible
La Bible se présente comme la Parole de Dieu. En effet, de nombreuses expressions indiquent explicitement que le message vient de Dieu lui-même (par exemple : « ainsi parle le Seigneur » en Ésaïe 66.1). D’autres affirmations très fortes vont dans le même sens, par exemple : « Toute Écriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3.16).
Le Coran
Le Coran affirme également être Parole de Dieu. Non pas, toutefois, pour révéler Dieu – ce serait une atteinte à sa transcendance – mais pour en faire connaître la volonté. Les musulmans croient en effet qu’un Livre céleste préexistant appelé le Kitâb, « les feuillets d’Abraham » ou encore « la Mère du Livre » consigne la volonté de Dieu, sa connaissance éternelle et infinie. Selon la tradition islamique, Dieu a révélé, au cours de l’Histoire, des parties de ce Livre aux Gens du Livre (Juifs et chrétiens). C’est ainsi qu’il a transmis la Thora à Moise, les Psaumes à David et l’Évangile à Jésus. Quant au Coran, les musulmans l’ont d’abord présenté comme la suite de la révélation de Dieu puis en sont venus à le considérer comme le Livre contenant toute cette révélation[1]. Pour eux, il complète et clôt la révélation.
Les Veda
Les hindous considèrent que les textes sacrés de leur religiojn, les Veda, sont une révélation, non-humaine, d’une parole éternelle. On retrouve quatre recueils des Veda, organisés hiérarchiquement, selon leur ancienneté :
– le Rig-Veda (savoir des strophes),
– le Yajur-Veda (savoir des formules sacrificielles),
– le Sâma-Veda (savoir des mélodies)
– et l’Anthavra-Veda (savoir d’Atharva).
Des Samhitâ (collection d’Hymnes) et Brâhmana (commentaires sur le sacrifice), composent ces recueils.
Âranyaka (textes ésotériques) et Upanishad (texte spéculatifs). Ces Veda sont « à la base des cultes et spéculations de l’Inde ancienne. Ils montrent une conception optimiste de la vie et une croyance aux pouvoirs infaillible des rituels »[2].
Les quatre nobles vérités
Quant au bouddhisme, il a tellement connu d’évolutions dans son histoire qu’on trouve « aujourd’hui plusieurs canons d’“écritures saintes” bouddhiques »[3]. Néanmoins le sermon sur les « quatre vérités » qui aurait été prononcé par Bouddha est admis par tous :
– la première noble vérité porte sur la souffrance (dukkha). Elle est associée à la vie ;
– la deuxième sur l’origine de la souffrance (dukkha), la soif et le désir ;
– la troisième sur l’issue de la souffrance (dukkha) ;
– et la quatrième sur la voie permettant d’atteindre l’issue de la souffrance (dukkha).
LES DIFFERENCES ENTRE LA BIBLES ET LES AUTRES TEXTES SACRES
Les principales différences portent sur le mode de révélation revendiqué par les textes et sur le contenu lui-même.
Le mode de révélation revendiqué
La différence entre la Bible et les textes sacrés du bouddhisme et de l’hindouisme est assez nette. Ces derniers ne se réclament pas d’un Dieu unique et personnel. Nous ne nous y attarderons donc pas. En revanche, il est nécessaire d’examiner quelques aspects de la Bible et du Coran, qui se réclament tous deux d’un Dieu unique. La Bible a été rédigée en trois langues (hébreu, araméen et grec). Une trentaine d’auteurs, ayant vécu en divers endroits du Proche-Orient, et ayant écrit dans une période d’un millénaire, sont à l’origine des textes de l’Ancien Testament.
Quant au Nouveau Testament, il rassemble les textes qu’une dizaine d’auteurs ont écrits en une cinquantaine d’années, alors qu’ils vivaient dans l’Empire romain du premier siècle. La Bible, bien qu’elle se présente comme Parole de Dieu, est aussi parole humaine. En effet, Dieu s’est servi d’auteurs humains (prophètes et apôtres), de leurs réflexions, de leurs sensibilités et de leur histoire…pour parler aux hommes. Cette révélation s’est faite de manières diverses (Hébreux 1.1) : paroles directes (Nombres 12.6-8), songes et visions (Jérémie 23.28 ; Daniel 2.19), etc.
A propos du Coran, la tradition musulmane affirme que l’ange Gabriel l’a « descendu » par fragments à Muhammad seul, au cours d’une période de vingt-deux ans, en une seule langue, l’arabe et en deux lieux précis: la Mecque et Médine. D’après les Hadith (dires attribués à Muhammad), les modes de révélation auraient varié : paroles dictées par un ange, expériences extatiques parfois éprouvantes, visions en plein sommeil, etc. Dans tous les cas, Muhammad devait apprendre par coeur les paroles révélées pour les réciter à ses disciples afin qu’ils les mémorisent à leur tour. Contrairement aux auteurs bibliques, il a assuré la transmission de cette révélation de manière mécanique, c’est-à-dire sans que la formulation du message ne demande son implication personnelle. À la mort de Muhammad, l’ensemble de la révélation coranique forme un corpus de 114 sourates (chapitres) dont les plus longues sont au début – exceptés la première – et les plus courtes à la fin, celles-ci étant les plus anciennes[4]. On peut noter ici deux différences majeures avec la Bible.
1) Facteur temps : la révélation biblique s’étale sur plus de mille ans, tout en gardant sa logique et son harmonie. Certaines révélations annoncées au début de la Bible se sont réalisées par la suite, comme la venue de Jésus, annoncée dans la Torah (Deutéronome 18.18) et accomplie plus de dix siècles plus tard. L’histoire a donc confirmé la véracité de ces révélations et prédictions. La révélation coranique, elle, n’a duré que vingt-deux ans. Mais pour les musulmans, ce court laps de temps renforce la crédibilité du message coranique.
2) Nombre d’auteurs : la Bible compte plus d’une quarante d’auteurs ayant écrit dans des contextes très divers et à des périodes différentes de l’histoire. Pourtant, leurs messages constituent un ensemble harmonieux et cohérent. Le Coran, par contre, a été rédigé sur la base unique des révélations données à Muhammad, ce qui fait la grandeur de son unité littéraire. Mais on peut considérer cela comme une faiblesse. Il est en effet beaucoup plus facile à un seul auteur d’écrire un ensemble cohérent en vingt-deux ans qu’à une quarantaine en plus mille ans – à moins que Dieu n’ait été leur inspirateur commun !
Lire aussi: La Bible est loin du Coran
Le contenu
Enfin, la Bible se différencie des autres livres religieux par son contenu. Toute la « littérature sacrée » (les Veda, le sermon sur les quatre vérités et le Coran) met l’accent sur des pratiques, des lois et des rites…sensés rendre l’être humain meilleur et lui permettre d’accéder à une piété supérieure, avec les récompenses qui l’accompagnent. A l’inverse, la Bible insiste sur la nécessité d’une transformation intérieure de l’homme dont doivent découler des transformations de son comportement. Son message central se résume en quelques propositions : par sa désobéissance, l’être humain s’est éloigné de Dieu. Néanmoins, mu par son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui, pour sauver l’homme, a accepté de porter et expier son péché en mourant sur la croix.
Dès lors, la seule chose demandée à l’être humain, c’est de reconnaître son péché et d’accepter le pardon donné en Jésus-Christ. Quiconque reconnaît son péché et croit au sacrifice de Christ entre dans une relation personnelle avec Dieu, Dieu qu’il peut désormais appeler « Père » (Romains 8.15). A la différence des autres livres religieux, la Bible affirme que c’est Dieu qui sauve l’être humain et non l’être humain qui gagne son salut par ses efforts religieux. Tel est le message central de la Bible. Et cela en fait un livre unique.
Notes
[1] M. Arkoun, « “Coran” : sens coranique », dans Dictionnaire du Coran, s. dir. Mohammad Ali Amir-Moezzi, Paris, Robert
Laffont, 2007, p.188. Tous les spécialistes ne soutiennent pas cette identification du Coran au Livre : pour un avis contraire, voir J.M.F. Van Reeth, « Nouvelles lectures du Coran. Défi à la théologie musulmane et aux relations interreligieuses », Communio, septembre-décembre 2006, p.6.
[2] A. Astier, Comprendre l’Hindouisme, 3ème éd., Paris, Eyrolles, 2008, p.44.
[3] C. Leroux, Un regard Chrétien sur le Bouddhisme, Croire Pocket, Paris, 2008, p.37. Livre recommandé pour aller plus loin sur le sujet.
[4] Pour une bonne comparaison entre la Bible et le Coran, lire C. Moucarry, La foi à l’épreuve, L’islam et le christianisme vus par un arabe chrétien, Québec, La Clairière, 2000, p.17-71.